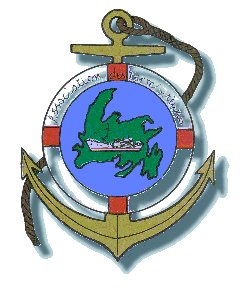Cette causerie de Simon Levacher s’est tenue le 4 janvier 2026 sur invitation de l’Association des Terre-Neuvas de Fécamp lors de sa traditionnelle galette des rois.
Pour approfondir sur ce thème, nous recommandons la lecture de « La boucane Levacher » (cf. notre médiathèque).
Introduction
Avant de commencer, meilleurs vœux à toutes et à tous pour la nouvelle année.
Je voudrais aussi remercier très chaleureusement Daniel Savoye, ainsi que les membres de l’association, pour leur invitation à venir vous parler aujourd’hui.
Même si le moment festif s’y prête peut-être mal, je souhaite dédier cette causerie à la mémoire de mon ami Colin Marais, disparu en juin 2023.
Colin travaillait sur les Terre-Neuvas fécampois pendant la Seconde Guerre mondiale.
Sa thèse, en cours de publication, a nourri une partie de cette réflexion, mais surtout, elle a profondément renouvelé notre regard sur cette période de l’histoire maritime.
Cette causerie lui doit beaucoup, car c’est en partie grâce à lui que j’ai repris mes recherches sur la boucane et l’armement Levacher.
Ce que je vous propose aujourd’hui, ce n’est pas tant l’histoire d’une famille que celle d’un armement, et d’une certaine manière de penser la pêche.
Dès la fin du XIXᵉ siècle et tout au long du XXᵉ, Louis Pascal Levacher, puis son fils Louis Joseph, s’inscrivent pleinement dans la vie du port, en siégeant dans les syndicats et en investissant dans l’industrie du poisson.
La causerie portera sur les bateaux, sur les types de navires armés, les formes de pêche pratiquées, les risques encourus, et le rôle de l’armement dans l’équilibre — parfois fragile — de l’activité de la famille Levacher, fondée sur le saurissage et l’industrie de la pêche.
L’armement est une activité rentable, mais profondément risquée, dépendante des hommes, de la mer, des marchés, des règles et de la ressource elle-même.
Pour en comprendre les logiques, il faut revenir aux origines.
Le premier Levacher connu dans l’armement est Clément Levacher, maître cordier à Saint-Valery-en-Caux, qui arme le Jeune Albert en 1857.
En 1872, sa fille Louise épouse Pascal Tougard ; le couple s’installe à Fécamp, rue Sous-le-Bois, actuel Quai Guy de Maupassant, où débute l’activité de saurissage, puis d’armement.
À partir de là, tout se met en place : une famille, des bateaux, un port, et une même logique économique et maritime, que je vous propose maintenant de suivre.
L’armement Tougard-Levacher
Pour commencer, je ne vais pas vous parler immédiatement de chiffres et de tonnage.
Je voudrais vous emmener en mer.
De nuit.
Dans le brouillard.
Nous sommes en 1905, sur les bancs de Terre-Neuve.
À bord du trois-mâts barque Para, un navire bien connu à Fécamp.
Un bateau solide, avec un capitaine expérimenté.
Parmi l’équipage, un mousse de treize ans, Joseph Lecœur.
C’est sa première campagne.
Ce qu’il raconte, ce n’est pas l’histoire d’un bateau.
C’est celle d’un instant.
Je le cite brièvement :
« Il était environ deux heures du matin. Un bruit terrible se fit entendre. Sous le choc, notre navire bascula. »
Les fanaux sont allumés.
La corne de brume sonne.
Mais cela ne suffit pas.
Le choc est violent.
La panique gagne immédiatement le bord.
« Cris dans la nuit noire. J’entends la voix d’un père ayant ses deux enfants à bord se lamenter sur leur sort. »
Ce passage rappelle que sur ces navires, il n’y a pas seulement des marins aguerris, il y a des hommes.
Il y a des mousses, parfois très jeunes.
Et parfois il y a des familles.
Le Para a été abordé par un navire qui a continué sa route.
“Un délit de fuite”, comme disent les policiers.
Il commence à prendre l’eau.
La situation est critique.
Les pompes entrent en action.
À ce moment-là, le récit de Lecœur s’efface pour laisser place à une autre voix.
Celle du capitaine Quesnel.
Le rapport du capitaine est un document officiel, destiné à l’administration et aux assurances.
Le ton est froid, précis, technique.
Il décrit les précautions prises dans la brume — veille renforcée, signaux sonores — puis constate l’évidence : le navire est perdu.
L’équipage est intégralement évacué.
Il n’y a pas de victime.
Une décision s’impose alors.
Le Para est incendié volontairement afin d’éviter toute dérive dangereuse.
Un geste professionnel, lourd de responsabilité.
Le Para disparaît.
Et avec lui s’achève l’armement Tougard.
Le naufrage de 1905 entraîne une décision immédiate.
Louise Tougard, le plus souvent désignée dans les sources comme la veuve Tougard, cesse toute activité d’armement.

Pour comprendre ce choix, il faut regarder en arrière.
L’armement Tougard a compté plusieurs navires — le Kléber, le Louise, le Père-Jumée, puis le Para.
Les campagnes sont régulières, parfois très bonnes.
En 1891, la capitaine du Louise, Hubert, réalise la meilleure pêche de la campagne en livrant 158 000 morues à Bordeaux.
En 1897, le Para réalise l’une de ses meilleures pêches, avec 331 tonnes de morue.
Mais le risque est permanent.
Et ce risque, Louise Tougard l’a vu de près.
Son frère, Pierre Levacher, est lui aussi armateur à Saint-Valery-en-Caux, dans le même quartier maritime que Fécamp depuis 1892.
Même mer.
Mêmes dangers.
Les drames s’enchaînent.
En 1882, le Saint-Jean-de-Dieu disparaît au large de la Somme avec quatorze hommes.
En 1894, le Fraternité est abordé par un vapeur anglais à Yarmouth : l’équipage est sauvé, mais le navire est immobilisé à l’étranger à grands frais.
Puis vient l’irréparable.
En 1897, le Liberté se perd corps et biens en mer d’Islande.
Vingt-trois hommes disparaissent.
Nous conservons une lettre écrite alors par Pierre Levacher à un fournisseur de filets, Favraux.
Le ton est professionnel, presque administratif, mais l’angoisse affleure :
« D’après les nouvelles d’Islande qui viennent de m’arriver de mon chasseur, m’apportant la nouvelle que mon bateau pêcheur (Liberté) n’était pas paru en Islande. »
Puis :
« Dans l’espoir de recevoir de meilleures nouvelles… »
Et en post-scriptum :
« Ce bateau est sorti de Saint-Valery le 18 février et n’a encore été rencontré par aucun navire. »
Pierre Levacher est ruiné.
Louise Tougard, elle, s’arrête à temps.
Elle quitte la grande pêche sans attendre le naufrage de trop.
Dès 1901, la presse évoquait déjà la perte corps et biens de la caïque Louise, appartenant à son armement.
Au début du XXᵉ siècle, Fécamp est un port extrêmement
concurrentiel, avec plus de soixante-dix navires armés en 1903.
La pression économique est forte, les risques parfaitement connus.
Louise Tougard recentre alors son activité sur la corderie, Côte de la Vierge, et sur la saurisserie du quai Guy de Maupassant.
Elle investit également dans l’immobilier locatif à Yport.
Cela ne signifie pas un retrait complet de la mer.
À Saint-Valery-en-Caux, Arthur Levacher, son neveu, exploite le Marceau pour la pêche au hareng et au maquereau.
Et en 1904, Louis Pascal, lui aussi neveu de Louise Tougard et déjà propriétaire de la boucane de Fécamp, arme le Laborieux pour la pêche au maquereau.
Autrement dit, tandis que la grande pêche révèle ses limites, d’autres formes de navigation subsistent.
Plus modestes.
Plus proches de la côte.
Plus maîtrisables.
Louis Pascal Levacher
Avec Louis Pascal, né en 1877 à Saint-Valery-en-Caux, le rapport à la mer change.
Il ne disparaît pas, mais il se fait plus mesuré.
Louis Pascal connaît la mer.
Il vit sur les quais, fréquente les capitaines, les patrons de pêche, les chantiers.
Il navigue lui-même.
Une lettre de 1902, écrite par le constructeur Émile Capon, en dit long :
« As-tu raconté tes régates d’Étretat au capitaine Quesnel et compagnie ? »
Louis Pascal régate, manœuvre, connaît les vents — mais dans un cadre maîtrisé.
La presse locale le confirme.
En juillet 1910, il remporte les régates de Fécamp, catégorie bateaux de plaisance, sur cinq milles.
Il mène le Violette à l’arrivée en 2 h 55 min 05 s.
Ce n’est pas la grande pêche.
Mais c’est une vraie culture maritime.

Économiquement, Louis Pascal reste avant tout négociant-saleur.
Il fait tourner sa boucane avec les apports des armements fécampois, notamment celui de Jules Bajard puis de sa veuve.
Son mariage, en 1904, avec Marguerite Grivel, s’inscrit dans le même monde.
Elle est fille et petite-fille de pilotes et de sauveteurs en mer.
Une famille qui connaît la mer et ses dangers.
Louis Pascal tente l’armement, mais sans excès.
Avant la Grande Guerre, il acquiert une barque de pêche côtière, le Pax Labor.
Une seule mention en 1916 : une pêche discrète, sans éclat.
En 1911, il fait construire une seconde barque, le Petit Louis, du prénom de son fils, par Florimond Grivel, constructeur breveté au Havre.
Le bateau est armé pour les campagnes de 1912 et 1913.
Louise Tougard meurt en mai 1914.
Puis vient la guerre.
Louis Pascal est mobilisé, passe par Verdun, puis par la campagne d’Orient.
Entre novembre 1917 et février 1918, il obtient un sursis pour pêcher le hareng : la pêche reste indispensable.
Après-guerre, en 1923, il achète un drifter moderne, le Franc Picard, pour 35 000 francs.
Construit à Boulogne en 1919, long de plus de vingt mètres, armé pour le hareng au filet dérivant, le navire est solide, réputé.
On le surnomme le « bouchon » : il tient bien la mer.
Il est commandé par Pierre Ebran.
Mais les années 1920 bouleversent le port.
Les grands voiliers disparaissent.
En 1929, il en reste une dizaine.
En 1931, la Léopoldine fait sa dernière campagne.
La grande voile fécampoise s’éteint.
Dès 1905, Louis Pascal voit arriver le premier vapeur fécampois, puis les drifters — sept en 1913, dix-sept en 1924, vingt-sept en 1930.
Ce n’est pas seulement une évolution technique.
C’est la physionomie même du port qui se transforme.
Malgré ses qualités, le Franc Picard ne compense pas les risques.
En 1929, alors que la crise est là, Louis Pascal le vend.
Le navire part pour Alger, cédé à un armateur local.
Pour lui, c’est la fin de l’armement hauturier.
Il se recentre sur l’essentiel : la transformation du poisson, avec la boucane du quai Guy de Maupassant.
L’approvisionnement est assuré par les armements du port.
Le drifter Keryado II, qui alimente la boucane, livre ainsi plus de 900 000 kilos de poissons par an entre 1936 et 1939.
Ce bateau appartient à l’armement Vasse, puis à la veuve François.
Ce sont d’ailleurs les Vasse qui vendent la boucane du 44 Quai Guy de Maupassant à Louis Pascal en 1918.
Son fils, Louis Joseph, verra encore une autre étape.
En 1957, le Emmanuella désarme définitivement.
Avec lui, c’est tout un monde maritime qui disparaît.
Louis Joseph n’a pas reçu une éducation bourgeoise au sens classique.
Il a appris sur le tas, aux côtés de son père.
Dès 1928, à dix-sept ans, il entre pleinement dans l’entreprise.
En 1931, il parcourt la France pour visiter les clients, acheter, revendre, organiser.
En 1934, après la mort de sa mère Marguerite, Louis Pascal lui confie la direction effective de la maison, tout en restant présent.
La Seconde Guerre mondiale
Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, en 1939, Louis Joseph est mobilisé. Il a vingt-huit ans.
Affecté au 3ᵉ régiment du train des équipages, dans une compagnie sanitaire, il découvre très vite ce que l’on appellera la « drôle de guerre », que Marc Bloch décrira dans L’Étrange Défaite.
Dans ses lettres à son père, Louis Joseph ne parle guère de la guerre. Il parle d’ennui.
Il écrit qu’il « s’abrutit », que ses journées se résument à « l’appel, la revue, boire, manger, dormir ».
À distance pourtant, l’entreprise continue.
Dans leur correspondance, le père et le fils n’évoquent presque jamais la guerre, mais le hareng. Toujours le hareng.
Dès l’automne 1939, la question est posée : faut-il acheter malgré des prix très élevés ?
Louis Pascal hésite.
Louis Joseph tranche :
« Tâche de faire le plus de marchandise possible, même assez cher. Cela partira. »
En novembre 1939, Louis Pascal encaisse déjà cent vingt barils. Son fils le félicite :
« Tu sales beaucoup, tu fais bien. Il en faut. »
La boucane tourne. On lance même la fabrication des bouffis, ces harengs fumés vendus dix-sept francs la caisse.
Même mobilisé, Louis Joseph raisonne en chef d’entreprise : il suit les bateaux, le port, les possibilités de permission aussi.
En janvier 1940, l’hiver est rude.
Louis Joseph évoque des températures de moins vingt degrés.
« Neuf sur dix ont la grippe », écrit-il.
Lui-même est hospitalisé à Verdun en février, pour une grippe et des troubles intestinaux.
À Fécamp, après l’arrivée des Allemands, l’entreprise tient.
Louis Pascal est toujours là.
Sa voiture est réquisitionnée par la Kriegsmarine ; il se déplace désormais avec une carriole tirée par son fidèle cheval, Bijou, qu’il refuse de vendre.
On le voit ainsi pendant toute l’Occupation, silhouette familière et presque anachronique sur les quais.
Mais la guerre complique tout.
En novembre 1940, à peine rentré, Louis Joseph est arrêté pour recel d’essence volée à l’armée allemande.
L’affaire est grave.
Son père intervient, mandate un avocat.
Finalement, Louis Joseph est blanchi car rien ne prouve qu’il connaissait l’origine de l’essence.
À Fécamp, malgré l’Occupation, les structures professionnelles continuent pourtant de fonctionner.
Le Comptoir de vente des sécheries reste actif.
En 1942, on discute même de campagnes de pêche en Mauritanie ;
cinq navires sont cités.
Les résultats restent excédentaires.
La guerre ne touche donc pas tout le monde de la même manière.
Sur le plan personnel, en revanche, tout se délite.
Louis Joseph abandonne sa femme, Denise, et son fils Louis Alphonse.
Le divorce est prononcé à ses torts.
La famille évoque un homme parfois violent, avec son épouse comme avec son personnel.
Il pratique le marché noir. Les sources sont claires, et ce point n’est pas contesté lors de l’épuration.
Mais — et c’est essentiel — ce marché, comme l’a montré Colin Marais, n’est pas immédiatement perçu comme une faute morale.
Il permet de contourner l’occupant et de ravitailler certains réseaux de résistance.
Le regard ne change que plus tard, lorsque les privations s’aggravent et que les profiteurs deviennent plus visibles.
Cette position ambiguë vaut à Louis Joseph de solides inimitiés.
À la Libération, il est accusé de collaboration par le Comité de Libération de Fécamp et par une partie de la presse de gauche, puis interné à la maison d’arrêt Join-Lambert, à Rouen.
Pourtant, rien ne permet d’établir une collaboration active.
La boucane a même été occupée par l’armée allemande entre juillet et novembre 1941, sous contrainte.
Un témoignage en sa faveur — celui d’un résistant, vraisemblablement le capitaine Gilles — empêche qu’il soit reconnu comme collaborateur.
La sanction n’en est pas moins réelle et documentée :
- condamnation pour marché noir,
- poursuites pour bénéfices illicites,
- redressement fiscal sévère,
- privation temporaire des droits civiques.
Louis Joseph paie aussi son manque de respectabilité morale et, sans doute, le fait que certains ennemis personnels se retrouvent aux commandes de la ville à la Libération.
Comme l’a montré Colin Marais, d’autres armateurs fécampois ont pourtant pratiqué le marché noir, réalisés des bénéfices douteux, sans jamais être inquiétés.
Le contraste avec Louis Pascal est frappant.
Le père demeure respecté. Ancien combattant de la Grande Guerre, décoré, figure reconnue de la salaison fécampoise à sa mort en 1949.
Le fils, lui, possède une forme d’intelligence. Il est énergique, entièrement tourné vers l’entreprise — mais insaisissable.
C’est à partir de là que commence véritablement l’histoire de Louis Joseph Levacher.
Louis Joseph Levacher
Après la guerre, tout est à reconstruire : le port, et autour de lui ce qui faisait sa force industrielle.
La boucane Levacher, elle, a tenu.
Le bâtiment principal a été épargné, même si les annexes ont souffert.
Louis Joseph engage aussitôt la reconstruction.
Il confie les plans à l’architecte fécampois Maurice Cordonnier, assisté du Havrais Dagorne pour le béton armé.
Le gros œuvre est assuré par les frères Dumesnil, avec l’aide du personnel de la boucane.
Dès 1949, l’outil est de nouveau opérationnel : six bacs de salaison, une paquerie, la machine peut repartir.
Encore faut-il du poisson.
En 1945 et 1946, le problème n’est pas seulement de pêcher, mais d’y aller.
Les zones sont minées et chaque sortie en mer relève du risque vital.
Il faut attendre l’hiver 1946 et l’arrivée des dragueurs de mines pour retrouver des conditions de navigation acceptables.
Pourtant, dès 1945, les bateaux repartent.
Le Cap Fagnet revient de Terre-Neuve avec 700 tonnes de morue salée.
Le Simon-Duhamel appareille à son tour.
La pêche côtière reprend à l’automne. À Fécamp, vingt-huit embarcations sont armées, douze à Yport.
Les débuts sont difficiles, puis la situation s’améliore lentement.

Louis Joseph observe cette reprise avec attention.
Il ne possède pas encore de bateau et dépend entièrement du Souvenir, de la veuve Bajard, et de l’Emmanuella, de l’armement Ledun.
À partir de 1951, les signaux faibles se multiplient.
Les biologistes s’inquiètent et parlent déjà de surpêche.
Les techniques évoluent — chalut pélagique, chalut-bœuf — et la ressource devient plus incertaine.
La congélation apparaît.
Louis Joseph comprend une chose essentielle : pour sécuriser l’activité à terre, il faut sécuriser l’approvisionnement en amont.
Il entre alors réellement dans l’armement, avec prudence.
En 1957, il devient écoreur du Souvenir, tenant les comptes.
En 1958, il s’associe avec Philippe Lecanu, mareyeur, bientôt rejoint par Bajard.
L’armement est partagé en quirats – c’est-à-dire en parts égales, le risque aussi.
Les bateaux arrivent vite.
En avril 1958, le Franc Picard entre à Fécamp, commandé par Maurice Ebran, dit « la goélette ».
Trop petit, comme le Souvenir, il est revendu dès 1959.
En novembre 1959, l’armement acquiert alors à Boulogne le Saint-Pascal : quarante-deux mètres, 750 chevaux, un changement d’échelle assumé. Il terminera sa carrière en Grèce en 1971.
Dans le même mouvement, la flotte se renforce.
- L’Alain-Marie arrive en octobre 1958 ;
- Le Cap Bojador en mai 1959 ;
- Puis le Saint-Roger en 1962.
Avec ces unités, l’armement fonctionne.
Les campagnes sont bonnes, parfois excellentes.
En 1961, Jules Leporc remporte le palinot avec 1 750 tonnes débarquées — un record.
Il sera plus tard fait chevalier du Mérite maritime.
Le Saint-Pascal, le Cap Bojador, le Saint-Roger dépassent régulièrement les 140 tonnes par sortie, pour approvisionner la boucane et revendre le surplus.
Et pourtant, le paradoxe des années 1960 est là.
En 1960, Fécamp est le premier port français de pêche à la morue.
En 1962, l’Alain-Marie est le premier navire à livrer aux nouvelles halles.
Louis Joseph est conseiller municipal.
Tout semble fonctionner pour le mieux, dans le meilleur des mondes.
Pourtant, dès 1964, la crise éclate.
La campagne du hareng est exceptionnelle, mais l’offre dépasse la demande, et les prix s’effondrent.
L’État ne réagit ni face à la concurrence étrangère ni dans le cadre du Marché commun.
En octobre 1964, Louis Joseph, alors président du Syndicat des armateurs de la pêche fraîche, rencontre le ministre de la Marine avec une délégation importante de représentants du secteur.
En vain.
Il propose même une solution audacieuse : le regroupement des armements, pour mutualiser les moyens, renouveler la flotte de pêche et adapter le port aux nouvelles contraintes économiques, notamment la congélation, à laquelle Fécamp s’adapte tardivement.
Cette proposition est accueillie froidement.
S’ajoute un contexte social qui se durcit.
Les salaires stagnent, les conditions de travail restent rudes, les grèves se multiplient.
L’armement est pris en étau entre pression économique, tensions sociales et absence de réponses structurelles.
À cela s’ajoute un choc interne.
En février 1962, Philippe Lecanu se retire brutalement.
Bajard et Levacher doivent racheter ses quirats.
Une procédure judiciaire s’engage jusqu’en 1969, remportée par les deux associés.
Louis Joseph tente alors une autre voie, avec un bateau à lui, le Petit-Louis, conçu pour approvisionner directement la poissonnerie du Havre sous la marque Pêcheurs d’Islande.
Commandé par Gérard Hervieux, il est géré par son fils Louis Alphonse.
Le projet est cohérent, mais le bateau est trop petit, trop dépendant des cours. Il est finalement vendu — ironie de l’histoire — à Lecanu.
En 1965, l’armement Bajard–Levacher est liquidé.
Non par incompétence, mais par épuisement.
La concurrence, la réglementation, les incertitudes internationales ont eu raison de lui.
Les mêmes forces qui avaient déjà frappé les Tougard, puis Louis Pascal.
Louis Joseph revient alors à l’approvisionnement extérieur, notamment auprès de l’armement Ledun et du Shamrock III, puis de l’armement Leborgne, à Saint-Malo.
Il conserve néanmoins l’Alain-Marie jusqu’en 1972.
Mais le modèle est à bout de souffle.
Ce n’est pas l’échec d’un homme.
C’est la fin d’un monde maritime.
La boucane, elle, résistera encore jusqu’aux années 1990.
Conclusion
Pour refermer cette causerie, il faut revenir à son point de départ : l’armement.
Non pas comme une activité parmi d’autres, mais comme un choix structurant, qui engage bien plus que des navires.
Ce que montre l’histoire de l’armement Levacher, ce n’est ni un âge d’or, ni un déclin linéaire, mais une suite d’ajustements.
L’armement est toujours un prolongement de l’activité à terre, un moyen de sécuriser l’approvisionnement, de tenir une filière — au prix d’un risque permanent, financier, humain, parfois politique.
Avec Tougard, puis avec Louis Pascal, l’armement s’inscrit dans une logique de prudence et de durée.
Avec Louis Joseph, il devient plus tendu, plus exposé, dans un monde bouleversé par la guerre, la technique et les marchés.
À partir de là, armer devient une décision qui peut mettre en péril l’ensemble de l’entreprise.
La véritable histoire de cet armement ne se joue donc ni dans le nombre de bateaux, ni dans les campagnes de pêche, mais dans cette capacité — ou cette nécessité — de savoir quand il faut armer, et quand il faut renoncer.
Non pas une histoire de navires, mais une manière de penser la pêche comme un système, entre la mer, le port, les hommes et les marchés.
Simon Levacher